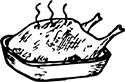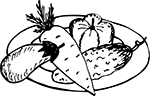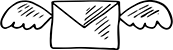#14 [Ottolenghi] Comment je suis devenue une végétarienne à mi-temps, ou comment Ottolenghi a changé ma vie - partie 1/4 : une longue introduction
Où on parle Sarlanoix et de l'importance de bien manger le soir, avec plein de liens vers des trucs à lire
Qu’y a-t-il de plus à raconter sur Ottolenghi - ou plus précisément, les 4 personnes derrière le groupe du même nom, à savoir Sami Tamimi, Noam Bar, Cornelia Staeubli et Yotam Ottolenghi lui-même ?
Que pourrais-je ajouter, après 5 millions de livres vendus dans le monde et une influence telle qu’elle a inspiré une tripotée de restaurants d’inspiration levantine dans nos villes, et qu’elle a rendue désormais banale la présence du sumac dans les supermarchés britanniques ?
Devrais-je publier ma propre photo de salade à la tomate et aux graines de grenade, alors qu’il existe déjà une multitude de comptes Insta dédiés uniquement aux tests de leurs recettes, et que le hashtag #icookedottolenghi rassemble quasi 40 000 posts sur Instagram ?
Et surtout, que pourrais-je écrire de plus, alors que d’excellents articles ont déjà été consacrés à Ottolenghi et ses partenaires ?
Je vous recommande notamment de lire en tout premier lieu le long et passionnant portrait publié dans le New Yorker il y a 10 ans, alors qu’Ottolenghi et ses acolytes commençaient à “changer la façon dont on mange à Londres”. Egalement intéressants, cet article sur goodfood.au, qui se demande comment “l’Ottolenghi effect” a déferlé sur la planète entière ; ainsi que ce portrait sur Le Monde publié en 2019, qui revient sur le parcours impressionnant d’Ottolenghi, le plaçant à la suite des emblématiques Nigella Lawson, Gordon Ramsay et Jamie Oliver :
La très upper-class Nigella Lawson avait appris aux ménagères britanniques à nourrir leurs familles, le volcanique Gordon Ramsay leur a fait découvrir les subtilités de la haute gastronomie mondiale, le sympathique Jamie Oliver les a décontractées avec ses recettes en quinze minutes et cinq ingrédients. Ottolenghi, en mêlant les influences israélienne, iranienne, turque, italienne ou française, est devenu synonyme de cuisine végétale et ouverte sur le monde – l’exact contraire de ce qu’on lui a enseigné au Cordon Bleu. Yotam Ottolenghi, épices and love, de Zineb Dryef
Que pourrais-je écrire de plus donc ?
Eh bien, peut-être une histoire.
Ou comment je suis devenue une végétarienne à mi-temps grâce à deux livres d’Ottolenghi.
Mais revenons aux débuts si vous le voulez bien :)
J’ai été une carnivore pendant la majeure partie de ma vie. Par habitude, parce que j’ai grandi en mangeant de la viande à chaque repas et ai continué à le faire à l’âge adulte. Mais aussi et surtout par goût premièrement, et deuxièmement, parce que certains plats font partie intégrante de mes souvenirs et de la personne que je suis devenue.
Je n’imaginerais par exemple pas ma vie sans la fameuse soupe vietnamienne, le phở, lien ténu avec mes origines familiales pour moi qui suis née en France. A chaque fois que j’en mange et que j’avale le bouillon jusqu’à voir le fond du bol, je me sens chez moi, même s’il se trouve que je suis assise dans un restaurant paumé à Torcy.
Le confit de canard avec des pommes sarladaises est un autre plat cher à mon coeur : en vacances dans le Périgord noir, je ne me souviens plus de la ville et encore moins du nom du restaurant où nous nous étions attablés, mes parents, mon compagnon et moi, mais je me souviens parfaitement du cadre un peu rustique, de la nappe à carreaux, de l’assiette avec le confit de canard et les pommes sarladaises, et du petit verre de Sarlanoix que le patron nous avait offert. On se sentait bien, et alors qu’on papotait de tout et de rien avec ce restaurateur tout en buvant cette boisson atrocement trop sucrée mais étrangement délicieuse, c’est devenu un de ces rares moments gravés dans ma mémoire où je me suis sentie explicitement française. Je me suis aussi sentie chez moi. La coupe du Monde de 98 ne m’avait fait ni chaud ni froid. Mais il s’était passé quelque chose à ce repas. Le Périgord - Zidane : 1-0
Ou c’est encore le goût tout simple d’une bonne tranche de pâté de campagne avec des cornichons et un verre de vin blanc, qui est l’une des innombrables raisons m’ayant amenée à entamer une formation en charcuterie il y a 6 mois.
Mais ce n’est pas seulement manger, c’est aussi l’étape en cuisine en amont qui m’enthousiasme. J’ai toujours aimé cuisiner de la viande, et depuis que j’ai entamé ma formation en charcuterie, le travail de la viande me passionne encore plus. Je craignais d’être rebutée par les carcasses et les volumes - c’est sûr que ce n’est pas la même chose entre cuisiner 2 cuisses de poulet à la maison et des dizaines de kilos de viande dans un labo. Mais c’est finalement le contraire qui s’est produit. Même alors que j’étais en train de faire des trucs que beaucoup de gens auraient trouvés dégueulasses - goûter le boudin à cru, éplucher des dizaines de langues de porc cuites, regarder le charcutier tailler à la scie des demi-carcasses de porc… Ma curiosité s’en est trouvée grandie.
Il n’empêche. Il y a environ dix ans, j’ai eu, comme pour beaucoup de gens, une première prise de conscience grâce au fabuleux essai de Jonathan Safran Foer, Faut-il manger les animaux ?, mélange passionnant d’enquête et d’histoire personnelle. J’étais évidemment touchée, mystifiée, révoltée par ce que racontait le livre.
Est-ce que cela a suffi ? Malheureusement, non.
Je n’aurai un déclic qu’après la lecture de plusieurs études démontrant l’impact écologique de l’industrie de la viande, mais aussi et surtout celle, il y a 2 ans seulement, d’un autre livre, un roman cette fois-ci. Un ouvrage que j’avais lu pour le travail et qui a fini par chambouler un peu ma vie. 180 jours d’Isabelle Sorente, un récit fait de fulgurances, de phrases assassines et d’images qui restent longtemps à l’esprit. Réflexion sur la mécanisation à l’extrême, lorsqu’on transforme le vivant en “unité productives”, le roman évoque toute l’horreur de l’élevage intensif. Pas seulement le supplice que vivent les animaux, mais aussi les conditions de travail ignobles des salariés, racontées à travers la rencontre entre un ouvrier et un professeur venu découvrir le quotidien d’un élevage à des fins universitaires.
C’est peut-être là que la fiction se fait encore plus forte que les chiffres et les faits : il m’aura suffi de l’histoire d’amitié entre deux hommes que tout oppose, fascinés par une truie trop intelligente pour son propre bien, pour me dire qu’il était temps de changer.
A partir de là, j’ai essayé plusieurs façons de diminuer ma consommation de viande. Seulement X fois de repas carnés par semaine. Essayer des versions végétariennes de plats que j’aimais bien. Chercher l’inspiration dans des livres de recettes végés aux couvertures pimpantes sur différents tons de verts.
Autant de méthodes qui se sont toutes soldées par un échec.
Peut-être que je rentrerai dans le détail un jour dans un article dédié, mais pour résumer, je terminais toujours avec une frustration à la fois derrière les fourneaux et devant mon assiette. Manger certains plats et cuisiner de la viande me manquaient, la vaste majorité des plats végétariens que je cuisinais me semblaient inintéressants et répétitifs dans leur saveur et leur préparation. En prenant conscience de cela, je me suis rendue compte à quel point varier et apprécier mes repas et leur préparation m’étaient bien plus importants que je ne le pensais.
J’ai des amis qui peuvent manger la même chose tous les jours pendant des semaines sans que ça ne les dérange. Qui sont sincèrement heureux avec une assiette de blé cuit et de légumes vapeur. Ou que ça ne dérange pas de manger un plat passable parce que le repas est “juste” une étape nécessaire avant de passer à d’autres activités plus intéressantes, plutôt qu’un moment de la journée à savourer en tant que tel.
Je me suis rendue compte qu’à contrario, le repas du soir en particulier était foncièrement important pour moi, que c’était presque une récompense après ma journée de travail. J’avais besoin que le contenu de mon assiette m’égaye et qu’il diffère de l’avant-veille comme d’après-demain, aussi simple soit-il, comme un fried rice improvisé avec les restes du bac à légumes et un petit morceau de lard, ou des spaghettis carbonara à la Gennaro.
Attention, je ne porte pas de jugement sur mes potes, n’allez pas lire ce que je n’ai pas écrit ! On a juste chacun nos hobbies, nos exigences, nos sources de joie à nous ; et à l’opposé, des trucs dont on s’en fout alors qu’ils sont essentiels au bonheur des autres.
Mais en attendant, je n’avais pas trouvé de solution au bout de plusieurs mois pour diminuer ma consommation de viande, sans être frustrée à la fois en cuisine et à table.
Et puis, je suis allée à la médiathèque et suis tombée sur le Cookbook de Yottam Ottolenghi et Sami Tamimi. Je l’ai pris sans connaître à l’époque l’histoire des deux auteurs. C’était par curiosité, juste pour voir, comme j’avais remarqué plusieurs fois leurs livres en tête de gondole en librairie.
Ce livre, ainsi que Jérusalem par la suite, a tout changé.
Après à peine quelques semaines d’exploration de leurs deux ouvrages, puis de leur site Internet, je n’étais plus quelqu’un qui s’efforçait de manger moins de viande. Mais quelqu’un qui avait appris à passionnément aimer des plats qui, en plus d’être savoureux, s’avéraient par ailleurs être sans viande.
Je n’étais plus dans la contrainte de manger moins de viande ; j’avais simplement découvert une cuisine différente, mais en même temps étrangement familière, qui était si excitante que viande ou pas viande, la question n’était plus là. Seule restait la joie de me préparer mon repas du soir et de savourer des saveurs qui n’étaient pas loins d’être aussi profondes que le phở de mon enfance.
Pour en savoir plus sur le Cookbook et Jérusalem… Eh bien, la suite la semaine prochaine ;-)
Merci de me lire, et à mercredi prochain !
Marjorie
Hopopop avant de partir ! Vous avez aimé cette newsletter ? N’hésitez pas à la partager avec vos ami(e)s fans de salades à la tomate et à la grenade et à vous abonner pour recevoir la suite de l’histoire dans votre boîte de réception !